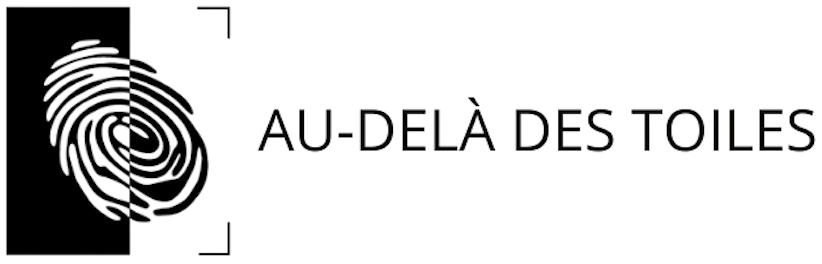Lucas Arruda, Untitled (from the Deserto-Modelo series), 2013, Oil on canvas, ©Lucas Arruda, Courtesy the artist, David Zwirner and Mendes Wood DM, Photography by Everton Ballardin
Il y a des expositions qui vous happent par leur promesse, et d’autres qui vous cueillent par leur silence. “Qu’importe le paysage”, la première monographie de Lucas Arruda dans un musée français, appartient clairement à la seconde catégorie. Nichée au cinquième étage du musée d’Orsay, là où la lumière filtre doucement sur les chefs-d’œuvre impressionnistes, cette exposition joue une partition délicate : celle de la mémoire, de l’intime et de la lumière. Beaucoup de lumière.
Lucas Arruda, ou comment peindre sans modèle (et sans filet)
Né à São Paulo en 1983, Lucas Arruda peint des paysages qu’il n’a jamais vus. Et c’est bien là tout l’enjeu : ses toiles, souvent de petit format, ne sont pas des reproductions du réel, mais des évocations. Des souvenirs flous, des atmosphères captées en atelier, à la force de l’intuition. Depuis plus de quinze ans, il développe la série Deserto-Modelo, un nom emprunté au poète brésilien João Cabral de Melo Neto, qui désigne des « modèles de désert » — comprenez : des paysages mentaux.
Ce n’est donc pas tant le lieu que la sensation qui compte. Et cette sensation, chez Arruda, passe par une obsession : la lumière.
La lumière, c’est son motif. Et son moteur.
Si Claude Monet avait ses cathédrales, ses peupliers et ses meules de foin, Lucas Arruda, lui, a ses ciels vibrants, ses jungles floues et ses brumes silencieuses. Le parallèle avec les impressionnistes ne s’arrête pas là. Comme eux, il peint en série. Comme eux, il traque la nuance, le changement imperceptible, le glissement d’un état à l’autre. Mais là où Monet observait, Arruda imagine.
Dans certaines œuvres, il gratte la surface de la toile pour faire jaillir la lumière de l’arrière-plan. Dans d’autres, il empile les couches jusqu’à effacer toute forme, ne laissant que l’intensité d’une couleur — presque un pixel géant.

Alfred Sisley, Le brouillard, Voisins, 1874, Huile sur toile, H. 50,5 ; L. 65,0 cm., Collection Musée d’Orsay, Legs Antonin Personnaz, 1937, © photo _ RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) _ Gérard Blot

Gustave Courbet, La Mer orageuse, 1870, Huile sur toile, H. 116,5 ; L. 160,0 cm., Collection Musée d’Orsay, Achat au Salon, 1878, ©photo _ GrandPalaisRmn (musée d’Orsay) _ Hervé Lewandowski

Lucas Arruda, Untitled (from the Deserto-Modelo series), 2018, Oil on canvas, ©Lucas Arruda, Courtesy the artist, David Zwirner and Mendes Wood DM, Photography by Everton Ballardin

Lucas Arruda, Untitled (from the Deserto-Modelo series), 2022, Oil on canvas, ©Lucas Arruda, Courtesy the artist, David Zwirner and Mendes Wood DM, Photography by Claire Dorn

Lucas Arruda, Untitled (from the Deserto-Modelo series), 2023, Oil on canvas ©Lucas Arruda, Courtesy the artist, David Zwirner and Mendes Wood DM, Photography by Chase Barnes

Lucas Arruda, Untitled (from the Deserto-Modelo series), 2023, Oil on canvas, ©Lucas Arruda, Courtesy the artist and David Zwirner, Photography by Chase Barnes

Lucas Arruda, Untitled (from the Deserto-Modelo series), 2023, Oil on canvas,©Lucas Arruda, Courtesy the artist, David Zwirner and Mendes Wood DM, Photography by Chase Barnes

Claude Monet, Le Bassin aux nymphéas, harmonie verte, 1899, Huile sur toile, H. 89,5 ; L. 92,5 cm., Collection Musée d’Orsay, Legs comte Isaac de Camondo, 1911, ©photo : RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Stéphane Maréchalle
Un accrochage audacieux dans la galerie impressionniste
Ce qui frappe dès l’entrée dans l’exposition, c’est le culot tranquille du commissariat : placer les œuvres de Lucas Arruda au cœur de la galerie impressionniste, à deux pas de Monet, Pissarro ou Courbet, c’est tout sauf anodin. Et pourtant, ça fonctionne. Les toiles de l’artiste brésilien ne détonnent pas, elles s’infusent doucement. Comme des murmures au milieu des cris de lumière du XIXe siècle.
Mention spéciale pour la salle où “La Mer orageuse” de Courbet dialogue frontalement avec l’un des ciels menaçants d’Arruda : la tension est palpable, mais aussi étrangement harmonieuse. L’exposition nous fait voyager dans des paysages imaginaires tout en nous ancrant dans une histoire picturale bien réelle.
Et si le vrai paysage était dans notre tête ?
Car au fond, ce que Lucas Arruda interroge, ce n’est pas le paysage en tant que sujet, mais notre rapport au visible. Ce que l’on projette, ce que l’on croit reconnaître, ce que l’on ressent. Il peint un entre-deux : entre abstraction et figuration, entre souvenir et sensation. On pourrait dire que ce sont des paysages sans lieu… mais avec beaucoup de présence.
En contemplant ces toiles, j’ai pensé à cette phrase du poète Manuel Bandeira, dont est tiré le sous-titre de l’exposition : « Qu’importe le paysage ? Ce que je vois, c’est la ruelle. » Une invitation à regarder autrement, à ne pas s’enfermer dans la carte postale, mais à rester attentif à ce qui nous touche, ici et maintenant.
Lucas Arruda n’impose rien. Il propose. Des images ouvertes, des souvenirs universels, des fragments de lumière qui attendent notre regard pour s’activer. C’est une peinture de l’intime, mais qui parle à tous. Une peinture sans GPS, mais avec une boussole intérieure.
Alors oui, qu’importe le paysage, pourvu qu’on ait l’imagination. Et une heure ou deux devant soi pour se perdre volontairement dans ces horizons flous.
À découvrir
FEMMES : l’exposition engagée de Pharrell Williams
À la galerie Perrotin
Les rêves et l’art
Quand l’inconscient prend vie sur la toile
Regarder autrement
Le rôle de la culture dans notre perception de l’art