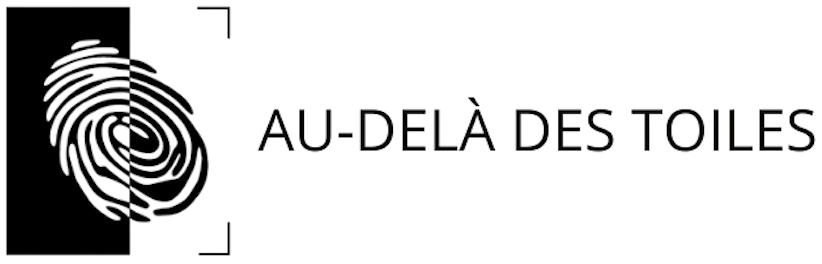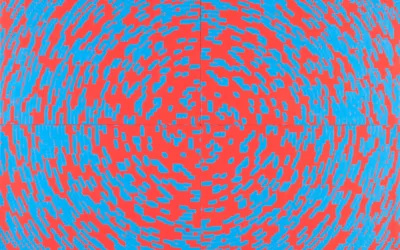Si notre cerveau joue déjà un rôle clé dans nos préférences artistiques – comme nous l’avons vu avec son câblage presque primitif en faveur de certaines formes ou couleurs –, que devient cet instinct face à l’immense influence de l’éducation et de la culture ? Car au-delà de nos circuits neuronaux, nos goûts artistiques sont aussi le reflet de ce que nous avons appris, expérimenté et assimilé tout au long de notre vie.
Le poids de l’environnement : un cerveau malléable face à l’art
Dès l’enfance, notre exposition à l’art commence : un tableau accroché dans le salon familial, des livres d’images colorés, une sortie scolaire dans un musée. Ces premières expériences laissent une empreinte durable sur notre manière d’appréhender l’esthétique.
Prenons un exemple : un enfant qui grandit entouré de paysages urbains, avec leurs structures géométriques et leurs teintes sobres, développera probablement une sensibilité différente de celui qui grandit dans une région riche en paysages naturels. Ce dernier pourrait trouver plus facilement du réconfort dans des œuvres représentant des horizons ouverts ou des formes organiques.
Les neurosciences confirment que notre cerveau, bien qu’influencé par des prédispositions biologiques, reste incroyablement plastique. Il est capable d’intégrer de nouvelles informations et de s’adapter à des environnements esthétiques variés. En d’autres termes, si votre goût pour l’art est en partie inné, il est surtout modelé par ce que vous vivez.
Éducation artistique : apprendre à décoder l’art
Si une œuvre ne nous “parle pas”, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas faits pour l’apprécier. Cela peut simplement vouloir dire que nous n’avons pas encore appris à l’interpréter. Car, tout comme apprendre une langue, l’art a son propre vocabulaire, que l’on découvre avec le temps.
-
Découvrir les codes : Prenons un exemple concret : la peinture abstraite. Pour beaucoup, elle reste hermétique. Pourtant, une fois que l’on comprend son histoire – une rébellion contre le figuratif, un désir d’exprimer l’émotion pure –, on peut commencer à y voir autre chose que des taches aléatoires. De même, la Renaissance ou l’art baroque deviennent plus fascinants lorsqu’on saisit les concepts sous-jacents, comme la perspective ou la symbolique religieuse.
-
L’art comme reflet de la société : L’éducation artistique ne consiste pas seulement à comprendre les œuvres elles-mêmes, mais aussi le contexte dans lequel elles ont été créées. Un tableau cubiste, par exemple, devient bien plus saisissant lorsqu’on sait qu’il émerge d’une époque marquée par une révolution dans la perception du temps et de l’espace. Ces clés de lecture, souvent enseignées dans les musées ou les écoles, transforment notre relation à l’art.
Culture et ouverture : explorer l’inconnu
La culture agit comme un prisme à travers lequel nous percevons le monde. Elle peut nous ouvrir à des formes d’art inconnues ou, au contraire, limiter notre vision en nous enfermant dans nos propres traditions.
- Les rencontres culturelles, un terrain fertile pour l’appréciation : Prenons l’exemple des masques africains. Dans leur contexte d’origine, ils sont souvent des objets rituels. Mais exposés dans des musées européens, ils deviennent des œuvres d’art admirées pour leur esthétique. Ces différences de perception montrent que notre environnement culturel influence non seulement ce que nous aimons, mais aussi la manière dont nous le regardons.
- Sortir de sa zone de confort : Pour élargir ses goûts, il faut parfois oser s’immerger dans des formes d’art qui nous sont étrangères. Cela peut passer par des expositions, des documentaires ou même des discussions avec des passionnés. L’art contemporain, souvent jugé difficile d’accès, devient plus compréhensible quand on prend le temps de découvrir ses intentions et ses références.
Une suite à l’histoire cérébrale
Si notre cerveau semble prédisposé à aimer certains éléments esthétiques, l’éducation et la culture viennent enrichir, modifier et même parfois contredire ces instincts primitifs. En apprenant à lire les œuvres et en explorant des contextes variés, nous pouvons développer une sensibilité artistique bien au-delà de ce que la biologie seule nous permettrait.
Alors, la prochaine fois que vous serez face à une œuvre incompréhensible, rappelez-vous : ce n’est peut-être pas votre cerveau qui fait blocage, mais une simple question d’apprentissage. Comme toujours, l’art est une invitation à évoluer. Et si vous osiez relever ce défi ?
À découvrir
Artiste libre avant d’être muse
Gabriele Münter – Peindre sans détours
Quand le génie se conjugue au féminin
Matisse et Marguerite – Le regard d’un père
L’illusion comme héritage
Quand l’art prépare l’ère numérique – Electric Op